Dans un monde où l’information circule en continu et où les notifications s’accumulent sur nos écrans, nous sommes confrontés à ce que les experts appellent désormais l’« infobésité ». Ce néologisme, récemment intégré au dictionnaire français, désigne cette surcharge informationnelle qui caractérise notre quotidien numérique.
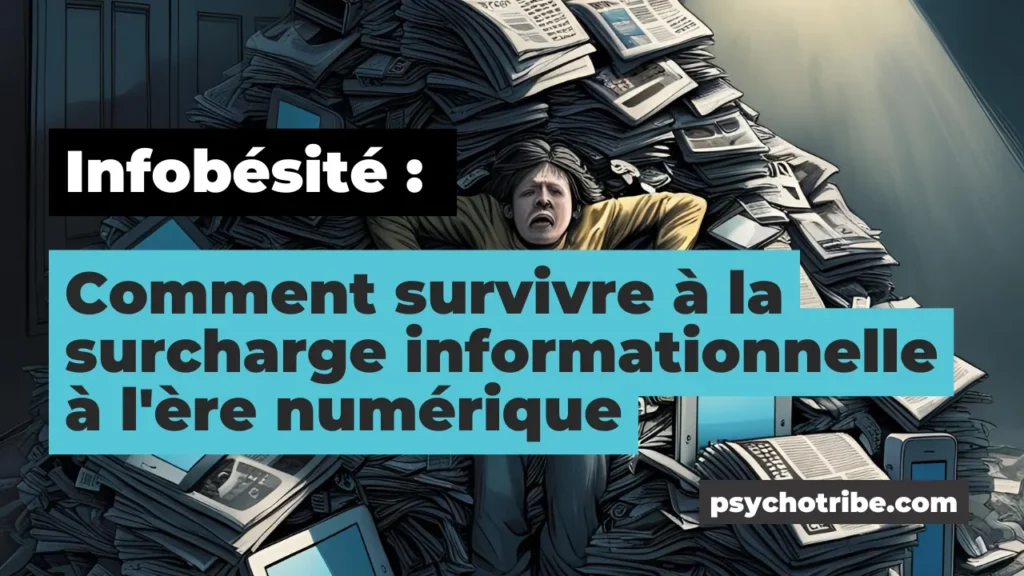
Comment ce phénomène affecte-t-il notre capacité à traiter l’information et quelles stratégies pouvons-nous adopter pour y faire face ? Plongeons dans les profondeurs de ce mal contemporain.
Qu’est-ce que l’infobésité ?
L’infobésité, contraction d’« information » et d’« obésité », désigne la surabondance d’informations à laquelle nous sommes exposés quotidiennement. Ce terme, ajouté récemment au dictionnaire Le Robert, reflète une réalité devenue omniprésente : nous sommes submergés par un flot ininterrompu de données.
Selon une étude d’IDC, la quantité de données créées dans le monde devrait atteindre 175 zettaoctets d’ici 2025, soit une croissance annuelle de 61%. À titre de comparaison, si l’on stockait 175 zettaoctets sur des DVD standard, la pile atteindrait 23 fois la distance de la Terre à la Lune !
Les impacts sur notre cerveau et notre bien-être
Notre cerveau n’a pas évolué pour traiter un tel volume d’informations. Comme l’explique le neuroscientifique Daniel Levitin dans son ouvrage « The Organized Mind », notre attention est une ressource limitée. Le multitâche constant auquel nous nous adonnons pour gérer cette surcharge informationnelle n’est qu’une illusion : notre cerveau passe en réalité rapidement d’une tâche à l’autre, consommant davantage d’énergie et réduisant notre efficacité.
Les conséquences de l’infobésité sur notre santé mentale sont bien réelles :
- Stress informationnel : Une recherche publiée dans le Journal of Medical Internet Research démontre que l’exposition excessive aux informations pendant la pandémie de COVID-19 a significativement augmenté les niveaux d’anxiété.
- Syndrome FOMO (Fear Of Missing Out) : La peur de manquer une information importante nous pousse à consulter compulsivement nos appareils, créant un cercle vicieux d’anxiété, comme le souligne l’étude de Przybylski et al. dans Computers in Human Behavior.
- Diminution de la capacité de concentration : Selon les travaux de Gloria Mark à l’Université de Californie, notre temps moyen de concentration est passé de 12 secondes en 2000 à 8 secondes en 2015.
Les mécanismes qui alimentent l’infobésité
Plusieurs facteurs contribuent à cette surcharge informationnelle :
L’économie de l’attention
Les plateformes numériques sont conçues pour capter et retenir notre attention le plus longtemps possible. Comme l’explique Tristan Harris, ancien éthicien de la conception chez Google, ces entreprises rivalisent pour monopoliser notre temps de cerveau disponible, transformant l’attention en marchandise.
Les algorithmes de recommandation
Ces systèmes, décrits par Eli Pariser dans son concept de « bulle de filtre », nous servent du contenu similaire à ce que nous avons déjà consommé, créant un effet d’entonnoir informationnel qui limite notre exposition à des points de vue diversifiés.
La culture de l’immédiateté
L’étude de Leslie Perlow de la Harvard Business School révèle que 70% des professionnels vérifient leurs emails dès leur réveil. Cette pression de l’immédiateté nous maintient dans un état d’alerte permanent.
Stratégies pour lutter contre l’infobésité
Face à ce déluge informationnel, plusieurs approches peuvent nous aider à reprendre le contrôle :
La diète informationnelle
Le concept de « digital detox », popularisé par Cal Newport dans son livre « Digital Minimalism », propose de faire des pauses numériques régulières pour permettre à notre cerveau de récupérer. Une étude de l’Université du Maryland montre que 24 heures sans médias numériques améliorent significativement le bien-être subjectif des participants.
La curation de l’information
Plutôt que de consommer passivement, devenons des curateurs actifs de notre flux informationnel. Des outils comme Pocket ou Feedly permettent de sélectionner des sources fiables et de planifier des moments dédiés à la lecture approfondie.
La pleine conscience numérique
L’étude de Jon Kabat-Zinn sur la pleine conscience (mindfulness) montre que cette pratique peut nous aider à utiliser les technologies de manière plus consciente et délibérée. Prendre conscience de nos habitudes numériques est la première étape vers un usage plus sain.
Les outils de gestion de l’attention
Des applications comme Freedom ou Forest nous aident à bloquer les distractions et à préserver des plages de concentration ininterrompue, essentielles selon les recherches de Cal Newport sur le « Deep Work ».
Vers une écologie de l’information
L’infobésité n’est pas une fatalité. Comme le suggère Howard Rheingold dans son livre « Net Smart », nous pouvons développer une véritable « écologie de l’information » en cultivant des compétences d’attention et de discernement.
La neurologue Frances E. Jensen recommande d’enseigner ces compétences dès le plus jeune âge, car le cerveau des adolescents est particulièrement vulnérable aux effets de la surcharge informationnelle.
Conclusion : Réapprendre à respirer dans l’océan informationnel
L’infobésité est le mal silencieux de notre époque hyper-connectée. Pour y faire face, nous devons réapprendre à filtrer l’information, à privilégier la qualité à la quantité, et à créer des espaces de déconnexion dans nos vies.
Comme l’écrit Nicholas Carr dans « The Shallows », « nous risquons de devenir des experts en tout et des spécialistes en rien ». Pour préserver notre capacité à réfléchir profondément et à créer du sens, nous devons cultiver ce que le philosophe Bernard Stiegler appelait une « pharmacologie du numérique » : apprendre à utiliser consciemment ces technologies pour qu’elles enrichissent notre vie plutôt que de la submerger.
Face à l’infobésité, la véritable richesse n’est plus d’accéder à l’information – désormais surabondante – mais de savoir laquelle mérite notre attention limitée et précieuse.


